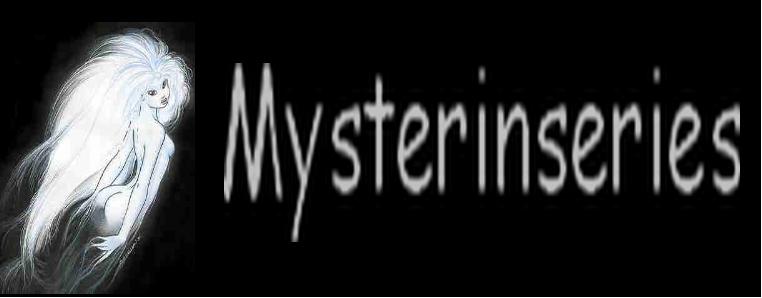
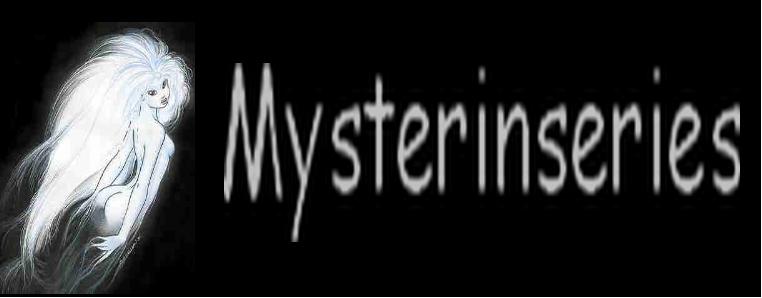
Une malédiction pèse sur le fauteuil 32 de l’Académie française. Cet énigmatique mauvais sort, vérifié par de nombreux historiens depuis l’origine, fut le sujet, en 1910, d’un roman fameux : Le Fauteuil hanté. Son auteur, le feuilletoniste Gaston Leroux, avait résolu l’énigme et en avait dissimulé les clefs dans son manuscrit.
Le destin voulut que Maurice Rheims, titulaire du fauteuil 32 de 1976 à 2003, devienne l’expert de la succession Leroux. Il reçut, pour rémunération de son travail, le mystérieux manuscrit. Au moment de mourir, il transmit à sa fille le précieux document pour l’aider à exécuter sa dernière volonté : que jamais personne ne s’assoie sur son fauteuil. Si elle parvenait à accomplir cette mission, malgré le déchaînement des ambitions et les sombres tractations des candidats, son père pourrait goûter à la vraie immortalité, celle des fantômes. Dans son treizième roman, Le Fantôme du fauteuil 32, Nathalie Rheims tourne une page. C’est avec une légèreté, un humour, une ironie mêlés de tendresse qu’elle fait revivre tous ceux qui entouraient son père afin qu’il n’attende plus que son éloge soit enfin prononcé.
Dans la réalité de l’Académie française : Le fauteuil de Maurice Rheims est resté vide pendant plusieurs années. Robbe-Grillet ne l’a pas occupé et Weyergans a tardé à s’y asseoir. Maurice Rheims peut enfin jouir de son immortalité et prendre de longues vacances dans son paradis corse. Mais un funeste destin s’est acharné contre lui. Cela faisait huit ans qu’il était enfermé sous la Coupole, où il attendait, en vain, d’être relevé. Pour être élargi, il suffisait que son successeur fît son éloge et vînt s’asseoir dans son fauteuil.
Seulement voilà: personne ne se présentait, et le commissaire-priseur commençait à prendre froid. L’auteur de «La Vie étrange des objets» se demandait si son fauteuil, le 32e, ne serait pas maudit. Son prédécesseur, Robert Aron, ne mourut-il pas la veille de son intronisation? Celui qui aurait dû le remplacer s’était bien moqué de lui, et de la Compagnie. Elu en 2004, Alain Robbe-Grillet n’avait en effet jamais prononcé son discours de réception et il avait refusé de porter l’habit vert, qu’il jugeait peu seyant, lui préférant le col roulé. Il est mort d’une crise cardiaque, en 2008, obligeant du même coup le pauvre Maurice Rheims à guetter un nouvel impétrant. Et ce fut, en 2009, François Weyergans.
On se souvient de la manière dont l’auteur du «Pitre» prit d’assaut le quai de Conti: avec un somptueux stylo à plume offert par Jean-Luc Delarue, célèbre tireur de lignes, l’écrivain adressa de longues lettres flagorneuses à tous les académiciens. Le procédé inédit fonctionna, et Weyergans fut élu au 32e fauteuil.Maurice Rheims pouvait-il enfin respirer? Rien de moins sûr. Car pour occuper ce satané fauteuil, il fallait encore que François Weyergans fût reçu sous la Coupole après avoir chanté les louanges de son prédécesseur. Et cela sai plus de deux ans qu’Hélène Carrère d’Encausse attendait, en pestant, cet improbable discours.
Il est vrai qu’on doit au plus gascon des romanciers belges, expert en procrastination et spécialiste des leurres, beaucoup de livres promis jamais remis, et des ouvrages publiés à l’arraché – il fallut près de dix ans aux Éditions Grasset pour mettre la main sur «Trois Jours chez ma mère», prix Goncourt 2005.
Mme le secrétaire perpétuel, qui n’avait toujours pas digéré l’épisode Robbe-Grillet, a trouvé dans les archives de l’Académie un article stipulant que le nouvel élu avait deux ans, pas davantage, pour se plier au protocole de la réception. Et elle a fixé à François Weyergans une date, au-delà de laquelle son ticket ne serait plus valable: le 16 juin 2011. Ce jour-là, dans un habit vert réalisé par Agnès b. et portant l’épée que lui a léguée Maurice Béjart, l’auteur du «Radeau de la Méduse» devait, pendant quarante-cinq minutes, célébrer celui des «Greniers de Sienne». Mais la rumeur prétendait qu’il n’avait pas encore rédigé une ligne de ce panégyrique. Jamais l’indolente Académie n’avait connu plus palpitant suspense. Le jour même, l’Assemblée dût encore attendre une demi-heure pour entendre le discours tant attendu. Le fauteuil 32 est aujourd’hui occupé.
C’est monsieur Guitté qui remplace le premier gardien et qui se désiste, lui aussi, après deux années de travail, n’ayant pu s’habituer à la vie d’ermite d’un gardien de phare à l’époque. C’est M. Patrick Whalem qui devient le nouveau gardien. Les sept premières années, tout va bien, mais le 8 avril 1880, M. Whalen aperçoit d’un grand nombre de loups-marins aux environs du rocher et décide d’aller les chasser.
Il est accompagné de son fils et de M. Thomas Thivierge, un ami qui était de passage. À peine les trois hommes arrivent sur la banquise qu’une tempête se lève et les glaces, poussées par la force du vent, s’éloignent si vite que les pauvres hommes ne réussissent pas à regagner leur demeure. Le lendemain, M. Thivierge retourne au Rocher, les pieds gelés et à moitié mort de froid. Il rapporte à l’inconsolable épouse du gardien que son époux et son fils sont morts pendant la nuit.
Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1880, Monsieur Charles Chiasson, du Hâvre-aux-Maisons, est nommé nouveau gardien du phare. Cette fois, l’accident survient un an plus tard. Le 23 août 1881, ses amis Paul Chenelle, Jean Turbide et la famille de M. Chenelle viennent en visite et leur hôte décide de leur faire un petit tour guidé des installations. Le groupe parcourt la tour, la bouilloire, les engins. Pour finir, ils s’approchent du canon d’alarme. Les visiteurs prient le gardien de bien vouloir tirer un coup de canon.
Le gardien accède au désir de ses invités, mais… hélas, le canon explose. Le gardien est tué sur place, tout comme son fils et M. Chenelle. L’assistant du gardien décédé, monsieur Télesphore Turbide est jugé compétent et nommé nouveau gardien. Après 10 ans de service sans aucun accident, au début 1891, une nouvelle explosion du canon survient, cette fois au moment où le gardien tire pour avertir des bateaux de passage. M.Turbide perd un bras. Le gardien suivant, M. Pierre Bourque, fait une chute grave du rocher en septembre 1896. Il est blessé et démissionne.
Le 7 mars 1897, par un temps magnifique, le nouveau gardien, M. Arsène Turbide, son fils Charles et son ami Damien Cormier aperçoivent un troupeau de loups-marins dans les alentours et décident d’aller à la chasse sur les glaces… ensuite… c’est la répétition des événements de 1880. Les chasseurs sont surpris par la tempête et emportés à la dérive. Le jeune Charles Turbide, 17 ans, et Damien Cormier, 60 ans, meurent de froid la première nuit qu’ils passent sur la banquise. Arsène Turbide, après trois jours et trois nuits sur la glace, sans aucune nourriture, les pieds gelés, fait terre à la Baie Saint-Laurent, mais il expire à l’hôpital.
On nomme immédiatement un nouveau gardien, M. Hippolyte Melanson. Cette fois, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que l’accident arrive… L’histoire est banale : le 12 juin 1897, le canon d’alarme explose et M. Melanson est grièvement blessé. Après cette troisième explosion du canon, on le remplace par un sifflet à air comprimé. Au début mars 1911, le gardien suivant, Wilfrid Bourque, est allé à la chasse des loups-marins) On connaît déjà la suite, n’est-ce pas? On a retrouvé son corps inanimé le lendemain.
Le gardien suivant (un héros sans peur, évidemment!), M. Elphège Bourque, neveu du feu gardien Wilfrid Bourque, vient occuper le poste du gardien l’été 1912. Pendant un temps, tout marche bien. Il ne va jamais à la chasse aux loups-marins. Le canon n’existant plus, on ne peut être victime d’une explosion, et il ne s’approche jamais des ravins…
Mais Monsieur Elphège Bourque, son frère Albin Bourque et M. Philias Richard, sont morts à la suite d’un empoisonnement par l’eau qui s’est fait mauvaise après une longue conservation dans un réservoir où était probablement tombé un animal. L’année suivante, personne n’exprimant le désir de postuler pour le poste de gardien du phare, celui-ci fut abandonné. Ici se termine la mystérieuse histoire de la malédiction du phare du Rocher-aux-Oiseaux.